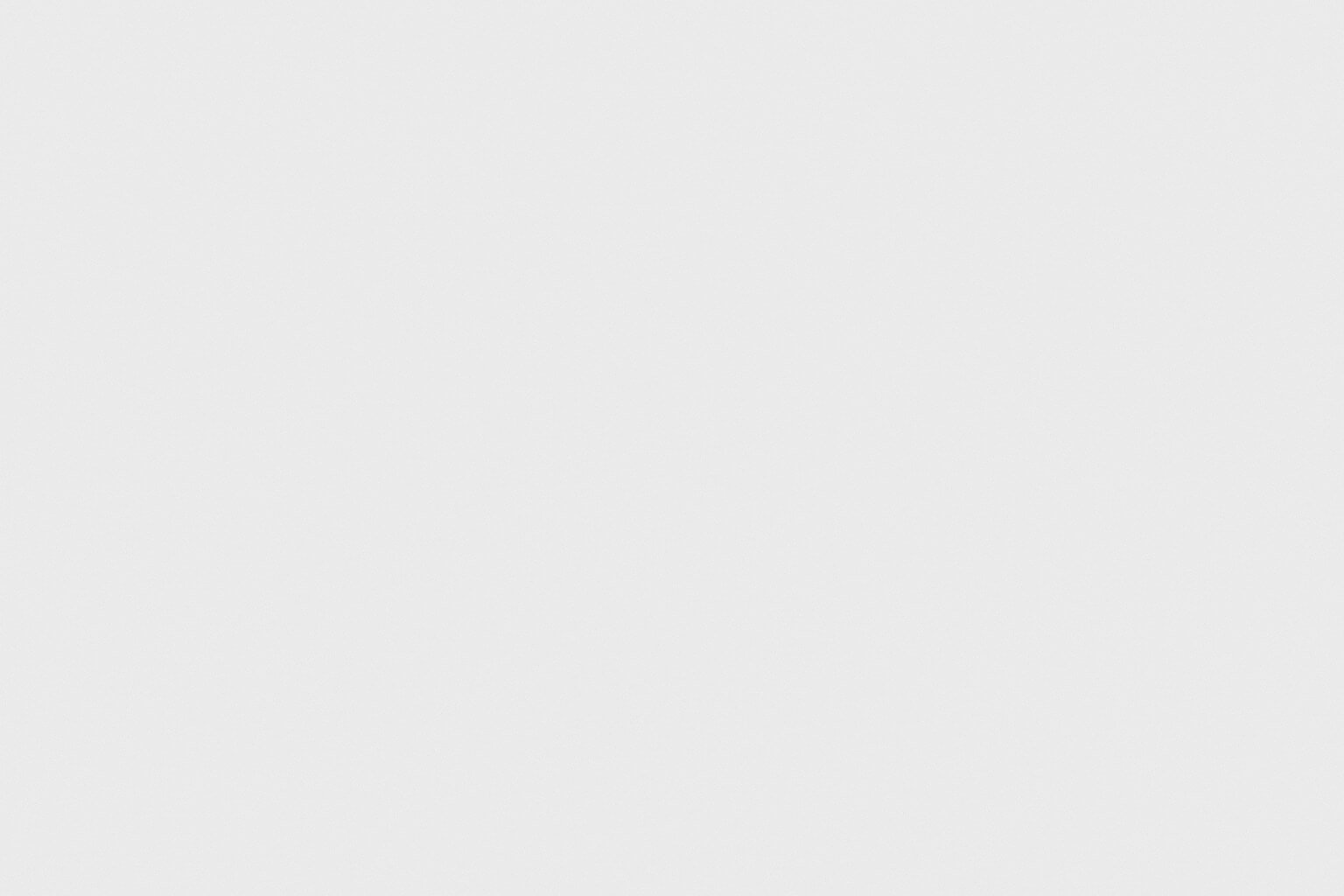Ces extraits ne sont pas un résumé du livre. Ils ne donnent pas non plus un aperçu exact du style de cet ouvrage, parfois ardu pour les non philosophes, notamment parce qu’ils ne permettent pas de montrer la large place faite par Florence Burgat aux pensées de plusieurs auteurs.
La résistance que les animaux opposent à leur saisie appartient pleinement à la lutte pour la reconnaissance du droit le plus fondamental : le droit à poursuivre sa vie. L’animal qui résiste à la prise manifeste son désir de vivre, de ne pas être capturé, tourmenté, blessé, enfermé, attaché ou tué. Tout être qui lutte, par les moyens qui sont les siens, exprime de fait la volonté de se voir reconnaître un droit à vivre. Ce vouloir-vivre spontané n’a pas besoin d’une argumentation théorique pour exister [[…]] (p. 25)
L’opposition entre vie et existence est un lieu commun philosophique qui doit beaucoup à l’existentialisme : vivre, simplement vivre, ce n’est pas encore, et même pas du tout, exister. Manuels de philosophie des classes terminales, volumes didactiques de « notions de philosophie », dictionnaires s’en font l’écho. Ce lieu commun est l’obstacle à surmonter pour penser la vie autrement que sur le mode dégradé auquel sa comparaison avec l’existence le condamne. (p. 29)
L’auto-constitution du vivant désigne la capacité qui est la sienne de se distinguer lui-même d’un environnement avec lequel il entretient cependant des relations. (p. 98)
Ainsi, parmi les éléments qui creusent l’écart entre le mode de vie des plantes et celui des animaux, le mouvement spontané occupe-t-il une place centrale. [[…]] L’autonomie et la spontanéité du mouvement propres à la vie animale semblent bien inaugurer quelque chose d’inouï dans la donne de la vie. (p. 99).
Qu’avons-nous donc peur de perdre en posant la question du sens dans le monde animal ?
Le fait pour un vivant de partir en quête d’une chose non encore à portée de main, de rendre en quelque manière présent ce qui est absent, n’est-il pas la marque du désir ? La distance qui sépare le désir de l’atteinte du but rend la différence entre la plante et l’animal manifeste. [[…]] La chose n’est pas donnée à l’animal, il lui faut affronter le monde pour l’obtenir. Pour persister dans la traversée toujours périlleuse du monde vers quelque objet, « le désir est requis », si celui-ci a pour condition essentielle « la satisfaction non encore à portée de main » et si « la satisfaction différée est en retour ce que le désir rend possible ». (p. 108)
Aux côtés des concepts et arguments propres à la philosophie morale américaine, ceux forgés par la phénoménologie fournissent un puissant levier pour contrer les motifs réductionnistes qui sous-tendent et justifient implicitement l’emprise sur les animaux. Peut-on en effet, insistons-y, leur octroyer un monde, une vie de conscience, un rapport au symbolique, une vie de relation, une voix, une existence inquiète et un sentiment de malheur sans que jamais cela soit pris en considération quant aux implications morales et politiques ? (p. 115)
Merleau-Ponty définit le comportement comme le pouvoir général de répondre à des situations par des réactions variées dont le seul point commun est d’avoir un sens. Il se démarque ainsi du schéma stimulus-réaction prévalant dans le contexte de l’hégémonie du réflexe, au profit de celui instauré par la Gestalttheorie (« Théorie de la Forme »), de situation-structure. (p. 167)
Le monde ambiant de la vie, les choses du monde – monde de l’action, monde des choses qui valent pour moi – ne sont-ils donnés qu’à l’homme ? N’y a-t-il que lui pour constituer les objets ? Ce monde-de-la-vie, cette certitude d’une existence continue au sein d’un ensemble ordonné et signifiant pour moi ne le sont-ils que pour la subjectivité humaine ? « Vivre, c’est continuellement vivre-dans-la-certitude-du-monde. » Les animaux vivent en ce sens, ils vivent dans cette certitude non réflexive qu’il y a le monde. Telle est l’une des thèses majeures de Husserl. (p. 249)
[[…]] On peut évoquer la croyance partagée par le plus grand nombre selon laquelle l’abattage ne pose pas de problème moral parce que les animaux ne réfléchissent pas. Ce qui veut dire ceci : parce qu’ils se représentent pas la situation comme « nous » le ferions en pareille circonstance, il ne savent pas ce qui leur arrive (comme s’il n’y avait qu’une seule espèce de savoir : l’expérience réfléchie en troisième personne), ce qui aboutit à l’étrange conclusion qu’ils n’ont donc aucune expérience ni sensation de ce qui leur arrive, il ne leur arrive rien, il se passe au plus intime d’eux quelque chose à quoi ils demeurent étrangers. L’erreur tient dans l’assimilation du vécu à sa représentation, et cette erreur se trouve consolidée sur un autre plan par la substitution d’une destination (les professionnels de l’élevage ne parlent-ils pas de « viande sur pied » ?) à tout autre qualité, réalité ou possibilité. [[…]] Ces lieux communs, le plus souvent ignorants de la tradition philosophique dont ils proviennent nous intéressent en tant que tels : l’équivalence entre la chose vécue et son concept, au point que la chose vécue sans son concept n’est même plus vécue, a profondément pénétré les esprits. (p. 345-346)
Nous marchons sur une croûte nette mais sous laquelle la putréfaction grouille. L’important est que nous n’en ayons pas la sensation – condition de la bonne marche du processus. Il y a bien ces camions chargés d’animaux que l’on croise parfois sur la route, mais où vont-ils ? Y a-t-il derrière les barreaux où l’on distingue leurs têtes des animaux malades, assoiffés, piétinés ? On ne sait pas. Le citadin a l’œil habitué aux livraisons du mort : les portes s’ouvrent sur des carcasses suspendues et proprement décapitées, qui seront donc découpées par « le savoir-faire de mon boucher » ; celui-là opère l’indispensable transition vers la convivialité. Certes, il a dû falloir tuer, mais ce savoir est vague, parce que le fait que les animaux veulent vivre leur vie n’a aucune consistance dans notre esprit ; partant leur mort n’a guère de réalité. (p. 371)